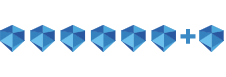Serblin & Son Performer.NET,
Performeur particulièrement net !
Par LeBeauSon - Octobre 2022
Perception d’ensemble
Un bon petit cru signé Serblin & Son !
le Performer n’est parfait nulle part mais très bon élève partout, un peu cabochard soit, réussissant un idéal équilibre entre toutes les subtiles composantes qui, amalgamées, creusent toute la différence entre un appareil hors norme, un bon appareil et un appareil médiocre.
Le dosage entre la finesse des couleurs, le délié, l’énergie et la transparence fait du gamin Serblin un appareil avec lequel on ne souffre d’aucun manque et mieux : on se laisse emporter par son enthousiasme vivifiant.
Ce qui, à ce prix, laisse pantois.
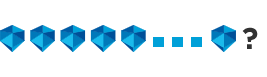
NB : Code couleur pour ce banc d’essai : Bleu, de 1600 à 3 200 €.
Le Performer est proposé aux alentours de 1750 € et 2000 dans sa version NET, ce qui place l’appareil plutôt vers le bas de l’échelle.

J’avoue que, quand le patron m’a fait parvenir le Serblin & Son Performer pour réaliser le BE, j’ai râlé.
-
- Encore un Serblin?
- Oui
- Qu’est-ce qu’il a de particulier ? C’est le quatrième qu’on teste ! Je suis désolé de te le dire, mais ça commence à tourner au népotisme
- Au quoi ?
- Au favoritisme
- Ah. Je m’en moque, les qualités d’ensemble surtout rapportées au prix me semblent justifier qu’on le défende !
- C’est-à-dire ?
- Moins de 2 000 € dans la version avec Streamer
- … Tu ne veux pas le faire toi-même, le BE, on avait dit que ce genre de petit truc, c’était pas pour moi
- Précisément, c’est intéressant, tu vas voir. Je veux ton avis
- Sur un machin au rabais ? Merci…
Le machin au rabais est resté dans son carton pendant plus d’une semaine avant que je me décide à l’en sortir.
Autant j’ai beaucoup aimé la bouille originale de la famille Frankie, autant celui-là, franchement… On dirait une babiole bas-de-gamme des années 70 sur les rayons Darty.
Bas de gamme, je suis sévère, car la finition est dans les bons standards, mais ce truc si petit avec son châssis en tôle peinte et sa façade en maigre alu est aussi excitant qu’un poulet dans un concours Miss Monde.
434 x 89 x 254 (dont 50 de bouton et connectique !)
A droite de la façade on ne peut plus dépouillée, les mêmes deux boutons que sur les Frankie (commutation des entrées et allumage/volume), font verrues ici.
Un écran d’affichage minuscule sur le quart droite d’une fine bande noire où sont inscrits la marque et le nom de l’appareil indique l’entrée sélectionnée et le volume en bleu. Cet intégré est fourni avec une télécommande !!!! C’est nouveau ça. Un petit bout de plastique format thermomètre qui fait le boulot. Merci.
A ce propos, il semble qu’elle accompagne dorénavant les Frankie. Pas une mauvaise idée, parce que franchement, repasser à chaque fois par la tablette pour régler le volume.
Le poids plume affiche 8 kg sur la balance.
Encore un Classe D… Me dis-je.
Eh bien, non : il est classe A/B !!!!
Donné pour 2 x 60 W sous 8 ohms et 2 x 100 W sous 4. Ce bidule ? sérieusement ?
Vous me direz, une alimentation bien ficelée, ça le fait aussi.
3 entrées lignes + deux entrées phono, en RCA.
Enfin non, pas deux entrées phono : une seule et à côté, une entrée pour insérer des plugs RCA avec la bonne valeur de résistance pour affiner la charge selon la cellule MC.
Les revendeurs vont adorer.
De mon côté, j’ai testé l’entrée phono sans me poser plus de question en sélectionnant MC, bien sûr, pour une Hana EL et ça s’est très bien passé.
2 entrées numériques S/Pdif, 1 coaxiale RCA, l’autre optique. Et, sur la version NET, une entrée RJ. L’appareil peut aussi être configuré en Wifi via une appli qui s’appelle Air Lino qui m’a cassé les pieds au bout de 10 seconde. C’est la deuxième fois que j’essaye ce gloubi-boulga et que ça m’énerve. On peut aussi parler au petiot en Blouetouss.
J’ai fait fi du Oui-Fi, ai connecté en RJ et testé via MConnect.
J’ai failli oublier la prise USB-A pour recevoir clef USB ou disque de stockage.
Et les sorties HP (oui, ils y ont pensé !) qui imposent des prises bananes.
Je n’ai pas trouvé des tonnes d’information côté technique si ce n’est que le petiot reprend le système de réglage de volume à relais analogiques 127 positions du Frankie. Un vrai luxe ! Qui n’est évidemment pas pour rien dans la transparence et la capacité aux nuances de ce petit machin.
Chouinard au moment de commencer le test, j’ai eu envie de piéger ce jouet et, euh… je me suis fait avoir ; prendre au jeu.
Ecoutes menées sur : Michell Tecnodec + Hana EL + Atoll ST300, Mulidine Cadence ++, hORNS Aria II et III et FP10, Atlantis Lab AT23 Pro, câblage Wing, Legato, Nodal, Mudra.

Qualité du swing, de la vitalité, de la dynamique :
Si je débute par cette rubrique, c’est précisément parce que, pour avoir voulu rapidement cerner le gadget, il s’est si rapidement imposé comme un petit bolide excité que je me suis pris à lui coller des enceintes de plus en plus performantes et exigeantes comme les Aria III hORNS dont le rendement ne crève pas le plafond.
Or, même dans ma pièce pour le moins énergivore, ce petit machin, en écoutant pourtant Un Point C’est Tout des Young Gods (extrait de Super Ready / Fragmenté en 2007) à un niveau vraiment pas raisonnable… hum… franchement déraisonnable, a passé l’épreuve avec une tranquille décontraction.
On a bien senti qu’il atteignait ses limites de réserve, mais ça ne s’est pas traduit par de la bouillie, dureté ou distorsion ou projection ou déséquilibre : à bout de souffle, le vigoureux petit bonhomme se contente de tasser un peu la dynamique, comme un limiteur très bien dosé !
Je suppose qu’il vaudrait mieux ne pas le laisser tourner trop longtemps à ce régime d’avion de chasse piloté par Tom Cruise, mais on peut visiblement se lâcher de temps en temps.
La frappe de caisse claire de Bernard Trontin claque avec une sècheresse rare – pas impossible que ce soit dû à la tendance de l’ampli à découenner, peut-être même habilement styliser - tandis que les sortes de glitchs qui l’accompagnent comme une poudre de fée dans le vent sont déclinés en nuances de modulation et transparence, transposant en parangon de minutie et de bon goût un pan créatif qui pourrait paraître aussi délicat qu’un bélier en rut.
Le texte alambiqué de Franz Treichler s’ébroue de l’ésotérisme dadaïste pour accéder à un double sens, poétique d’une part, mais aussi apparentant ses déclamations vocales au Vocalese.
L’émergence de la guitare stridente à mi-course n’est pas subie comme une roulette de dentiste car le jeune sportif Serblin ne distord absolument pas, d’une part, mais surtout maintient un degré de pouvoir de séparation des finesses internes de tout phonème élevé même lorsqu’il est chauffé à blanc.
Quant aux effets de soubassements électroniques et la ligne de basse, l’intelligibilité en est parfaite, grâce précisément à la « saine » transparence décapante du petit intégré qui ne confond pas résolution et chirurgie par extraction des attaques : ce petit machin est vraiment réactif.
Aïe, ça fait plusieurs rubriques d’un coup tout ça.
Et puisque j’ai évoqué le Vocalese, je me rue sur un célèbre exemple de l’exercice : Robert Charlebois et Louise Forestier chantant Lindbgergh (1968 ?), en vinyle, un sommet de contrôle de débit et sonorités des mots comme instruments dans ce texte joliment absurde…
Quelle surprise en ressortant un disque oublié depuis des lustres, de découvrir deux acteurs qui, par les montagnes russes des modulations ou les sourires caricaturaux, fourbissent des effets sidérants de swing laissant sur place les musiciens accompagnants au contraire prosaïques, ô combien. Ma mémoire encombrée d’inutile n’avait retenu de ce « sketch » que la complicité détendue des deux baladins et n’avait jamais considéré un esprit si hautement artistique dans ces apparentes élucubrations que le Performer verbalise avec le plaisir gaillard d’un moutard au Cirque.
Enfin, nous aurons pu jauger la « dynamique pure » lors d’une comparaison de plusieurs versions de la Symphonie n° 2 « de fer et d’acier » de Sergey Prokofiev, à commencer par une lecture relativement récente, Jurowski (2017, je crois) inaugurant sa nouvelle camarilla : l’Orchestre Symphonique Académique d’Etat Evgeny Svetlanov (en cyrillique, ça donne approximativement : Государственный Академический Симфонический Оркестр России de Е. Ф. Светланова, c’est beau, non ?). Chez PentaTone.
Jurowski outrepasse la tradition russo-soviétique par des tempi spacieux et des textures pleines, répudiant d’emblée l’aspect souvent grossier de diverses propositions très russkof martelant effectivement le fer et l’acier avec la distinction d’un bataillon de tanks lourds.
L’apostasie de Jurowski permet ainsi à un orchestre barzoï de rompre avec la phraséologie soviétique triomphaliste pour concilier une stylisation plus habituelle à l’ouest depuis quelques décennies. Impliquant une plongée dans un post-modernisme qui peut là aussi bouleverser la perception négative de l’œuvre – à commencer par celle de Proko lui-même -, car, alors même que les appels de trompettes - évoquant une chasse à courre industrielle - ne sont pas épargnés, le chef moscovite cajole de si nombreux morphèmes significatifs de l’inventivité de l’instrumentation qu’il nous extrait sans peine des beuglements dominants.
Si la captation de la version PentaTone est moins ample et profonde qu’on aurait pu l’attendre (face à celle très pointilliste d’Ozawa chez Deutsche Grammophon dont nous parlerons au moment venu), le rugissement des cuivres – que le Performer fait étinceler d’une verve affilée (trop ?) - n’oublie pas de rappeler les origines de l’orchestre. Certes nous avons connu des amplificateurs qui affirmaient une plus impérieuse volonté de prescrire à toute musique un spectacle intégral ; pour autant, l’ado italien ne jugule pas les fiers alignements de torses bombés en perspective sur une affiche de propagande à la gloire de l’Armée Rouge.
Et si l’exubérance - par un déploiement des forces aussi vaste que les unités de Darius le Troisième contre la cavalerie acérée des Macédoniens d’Alexandre (pas encore Le Grand qui, à une époque où les chars n’avaient pas la même efficacité que des T34, allait cependant triompher) – n’est pas le maitre-mot de la proposition du Performer, on apprécie néanmoins sa capacité à faire entrer chez vous dans un ordre rigoureux les légions au corps à corps, une invitation cordiale aux orchestres à ne pas bramer toute énergie déployée, préférant leur imposer un plan de bataille conquérant précis, rayonnant, dans une respiration et un climat ouvert sans être titanesque, ne perdant jamais la cohésion : pas de mise en avant fuyante, erreur de mise en place, ou quelconque refus de l’agencement tout militaire…
Pas mal pour si petit truc, drivant les Aria II hORNS, 88 dB de rendement. Un couple très réussi.
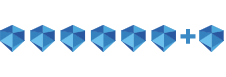

Timbres et équilibre tonal :
Ozawa maintenant dans une version ambivalente de la même œuvre (Berliner Philharmoniker 1991), insurpassée sur un point au moins : la performance de « civiliser » la barbarie sans se borner à la policer. Je pense que, s’il l’avait écoutée interprétée de la sorte, Prokofiev n’aurait pas rejeté ce travail de jeunesse qu’il voulait remanier.
Certes, les tempi choisis par l’éminent Japonais (notamment le thème principal du deuxième mouvement – l’un des deux seuls d’une structure superficiellement calquée sur la Sonate pour Piano n° 32 Op 111 de Beethoven) sont retenus, certes, oser la munificence des timbres et favoriser les finesses ductiles suivies d’assez près par le Performer comme par une gymnaste de la grande époque soviétique sevrée de dopage sont pour le moins décontenançants, mais cela signifie-t-il que cette version soit « romantique » ?
En aucune manière !
C’est au contraire sans doute une version des plus saignantes !
Bien sûr, feulée par Berlin, brassée de maestria et élégance par le Daimyo, une telle aperception sublime la sauvagerie comme le ferait Eric Rohmer d’une scène gore ! On est loin des cuivres rutilants de Rozhdestvensky, qu’on pourra d’ailleurs préférer (ou tant d’autres dont Erich Leinsdorf (Boston 1962…)), mais qu’importe : on profite sans réserve de la suprématie plastique du Berliner P à ses meilleures heures, et tant pis si ce formidable moment révèle peut-être une légère tendance montante ou confirme ce que nous soupçonnions précédemment du Petit Poucet Serblin : il n’aime pas le gras, impose un régime minceur.
Par conséquent, sur ce thème aussi on a connu de plus riches ouvertures de teintes ou nuances de pastels, mais il est important de comprendre d’où viennent la surprise et l’enthousiasme : le Performer n’est parfait nulle part mais très bon élève partout, un peu cabochard, réussissant un idéal équilibre entre les subtiles composantes qui, amalgamées, creusent toute la différence entre un appareil hors norme, un bon appareil et un appareil médiocre. Le dosage entre la finesse des couleurs, le délié, l’énergie et la transparence fait du gamin Serblin un appareil sur lequel on ne souffre d’aucun manque, ce qui, à ce prix, laisse pantois.
Je ne suis pas loin de penser que, si côté équilibre tonal il est moins « confortable » que le Frankie, il est possiblement plus juste, plus homogène en transparence. Alors on pourra préférer l’ampleur du grand frère à la « verdeur » du petit nouveau, mais je n’oserai affirmer que l’aîné à raison. Si ce n’est que, en comparaison, le cadet choisit d’aller à l’essentiel quitte à oublier quelques virages sur le parcours, quelques ombres dans les sous-bois, trop impatient de déboucher les brumes matinales que l’aîné contemplera plus sereinement.
« Verdeur » n’est pas le bon mot, mais oui, sur certaines enceintes très réactives, l’acuité plus tendue qu’un élastique de string sur une silhouette sous-estimée de deux tailles pourra raidir quelques musiques.
Cependant sur des AT23 par exemple, pas un type d’enceinte dormante n’est-ce pas, si on peut regretter la dureté native de l’enregistrement du Quatuor Amadeus « enlevant » La Jeune Fille et la Mort, D810 – Schubert, félicitations – version vinyle de 1960, que le Performer ne pardonne pas, on ne peut que se réjouir de ne rien perdre de l’exaltation de musiciens passionnés, qui parviennent - dans un emportement pouvant donner l’impression que la Jeune Fille est victime d’une agression à la hache (dans le premier mouvement) -, à infléchir de nobles différentiations de couleurs croisées, ainsi que d’élégants boisés.
Nymph est le premier album de la DJ londonienne Shygirl, pour lequel elle s’est entourée de quelques pointures (Arca, Bloodpop, Vegyn…) qui vont répandre habilement des condiments sonores décalés lorgnant vers le futur et déposant l’album sur un océan traversé de plusieurs courants – ambient, trip-hop, electronica ou pop, incluant les liants malins entre ces sous-genres - en préservant, sans doute grâce à l’artiste générique, une unité plutôt prenante.
En dépit de quelques glissades de vulnérabilité, la jeune femme n’exprime jamais le moindre doute ; et ce, qu’elle propose une balade particulièrement sensuelle ou une provocation purement charnelle, franchement impudique, plongée dans des textures torturées ou s’exhibant au bain de soleil…
Un truc qui n’entre pas dans la moindre case et fait mouche, détonnant dans la médiocrité actuelle.
Ce disque permet aussi de vérifier un point : l’équilibre tonal un rien montant du ténor transalpin – je ne parle pas d’une irrégularité de l’aigu mais d’une pente générale un poil inclinée – est moins critique en utilisant un lecteur réseau / DAC extérieur qui, soit, fait copieusement grimper la facture, mais prouve aussi que la partie amplification du Performer est proche du sans faute et dépasse largement son niveau de gamme.
Timbres :
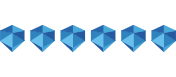
Equilibre tonal
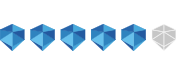
Attention aux enceintes toutefois, ne les choisissez pas froidement analytiques.
Réalisme des détails :
Dans l’insolite comète assimilable à du rock progressif étayé de traditions, donc folk, du jeune Mike Oldfield, compositeur plutôt inspiré (et guitariste émérite sans aucun doute mésestimé, tant il sait jouer beau et virtuose à la fois, qui n’a jamais trouvé la moindre place dans les compteurs du Guitar Hero) avant qu’il ne bascule vers une insipide musique de variété, je désigne son bizarre Hergest Ridge (1974), suite en deux mouvements typiques de ses trois premiers opus.
Hergest Ridge a connu il y a quelques années (2010) un remixage pour le moins surprenant, créant un relief bien supérieur aux instruments mais dénonçant parallèlement des faiblesses de jeu ou d’arrangements.
Ainsi la trompette se veut mélodique mais s’apparente dans ses maladresses à un clairon tenu par un bleubite cahotant lors d’une charge héroïque de la 7ème de cavalerie.
L’œuvre cependant, bien que moins variée peut-être que le sommet new-age Ommadawn, recèle de grands moments parmi lesquels les jamais imitées sept minutes de l’electric thunderstorm, tourbillon technique et acrobatique de sillons de boucles envoûtantes superposant 90 guitares électriques dans une folle série de loopings rythmiques au milieu desquelles quelques-unes négocient des virgules de dérapage hors sillage et quelques autres des chorus à peine scories d’une tempête de science-fiction dans l’attraction d’une supernova.
Sous l’œil impitoyable du Serblin Performer, l’amalgame des guitares modèle une symbiose rythmique qui virevolte impeccablement et élève l’ensemble vers plus de ferveur sans masquer les apartés, les griffures individuelles, les flammèches isolées…
Ce que l’on détecte sur les nombreux instruments acoustiques de l’album dont les enveloppes sonores sont d’une surprenante netteté, signe d’une vitre particulièrement propre mais possiblement aussi un peu amincissante : indéniablement, les matières sont ciselées dans des corps systématiquement athlétiques, parfois étiques. Fort heureusement, les développements des notes, leur prolongement dans un délié qui pourrait être celui d’un ampli à tubes, circonscrivent ce caractère qui ne deviendra problématique que sur des enceintes dépourvues de substance. Attention, il y en a.
Dans un genre radicalement à part, j’ai voulu approfondir l’analyse vers l’excès en choisissant la BO du film Sicario, du très surfait Denis Villeneuve, habile zélote de la putasserie carriériste ; ça ne doit pas être la première fois que je m’en prends à lui ; tout en reconnaissant que le bonhomme a souvent entre les mains des scénarii ou des thématiques intéressants, et que Sicario n’est certainement pas un mauvais film ; moins bon que la suite (par Stefano Sollima), soit, mais pas mal.
En revanche la BO électronique signée Jóhann Jóhannsson, disparu bien trop tôt, est absolument remarquable…
Mystérieuse et angoissante, fondée sur des grondements rythmiques magmatiques, l’exploration de l’extrême grave en est fondamentale. S’il n’est pas totalement creusé au plus profond par baby Performer, ses inflexions sont rendues particulièrement lisibles car désembourbées par la résolution qui excelle à révéler les modelés si ombrageux des martèlements telluriques confinant au chaos (dès The Beast), où il devient même difficile pour deux rochers de rester en équilibre l’un sur l’autre…
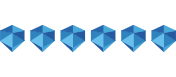
Scène sonore :
Allez, restons sur le thème de la Vocalese (vu ce qui va suivre, je suis vraiment sympa) et passons du New Age à la New Wave
Indochine !
Si si !
7000 Danses…
Côté Performer, je suis prêt à tout.
Quatrième album du groupe (je crois) en 1987, je me souviens avoir été attiré par la pochette (une influence japonaise, non ?) et par le fait que, quelques mois plus tôt, j’avais croisé le producteur, Joe Glasman, qui n’était (n’est ?) quand même pas un manchot. Contrairement aux musiciens. Euh…
Et puis, franchement, l’introduction de l’album (La Bûddha Affaire (?)) sur une valse agréablement chaloupée portée par une flûte enchanteresse s’avère pleine de promesse, n’est-ce pas ?
Malencontreusement, il y a la suite. Notamment « Les Tzars ». Mais il faut bien rire parfois quand même…
Nicola Sirkis (c’est russe, n’est-ce pas ? On n’en sort pas !) chante plus faux encore (et surtout à la limite du décrochage) que Robert Smith (The Cure pour les interrogatifs) mais sans le talent, la conviction et la soumission à son art, ce qui transforme la dissonance punk en vrilles irrécupérables… Quant à ses acolytes, ils peinent cruellement à dépasser la première page de « La Méthode de Musique pour Enfants » achetée la veille chez Paul Beuscher.
C’est d’autant plus regrettable que les ingrédients d’un vrai grand morceau sont réunis : une composition habilement structurée, un parti pris rythmique funky très malin et mieux encore, la prouesse sidérante de la production de Joe Glasman qui semble complètement se foutre d’avoir affaire à des musiciens qui s’épuisent à enchaîner poussivement deux notes de suite.
Oui, écrire des choses comme ça sur les enfants chéris d’une foule d’ados de tous âges - dont le premier concert post-confinement a servi de test biologique en vue de la sortie de crise pour l’ensemble de la culture : initiative d’intérêt public que de créer un cluster salutaire ? - rapproche le cou du lynchage ; et alors… Il y a bien eu un ministre pour désigner Aya Nakamura ambassadrice de la francophonie dans le monde !
Puisque nous sommes dans l’analyse de texte, il faut reconnaître que la poésie remarquable s’impose dès les deux premières strophes « Des Tzars » :
Dans une maison close, on les retrouve chacun dans leur chambre comme des fauves
Un secrétaire d'État, une eurasienne, les cosaques attaquent Natacha
Le vice-consul préfère les coups de fouet, une bûddha affaire qui va éclater
Mais qui a fait tuer Léon Trotsky
Les yankees s'amusent à Varsovie
Elle en veut aux tzars
Et 1, et 3, et 4 au placard
Un 5 à 7 en haleine pour mémoire
Et 1, et 3, et 4 au placard
Un 5 à 7 en haleine pour mémoire
Ouh wah, ouh wah, ouh wah, oh la la
Et Che, et Che, et Che Guevara
"Et caetera"
« Et caetera », c’est dans le texte.
Avouez que c’est du lourd… Et ça n’est que le début !
Allez, soyons gentils et supposons donc que cette prose est une variante de « Vocalese » dont la vocation est, comme nous l’avons évoqué, de sonner comme un instrument… Cette fois sans la moindre approche d’un sens.
Et pourtant… Pourtant, quel morceau, quel instant de la musique française sans aucun équivalent. Sérieusement…
Par les sonorités très typées, propriétaires, les idées d’arrangement, l’ambiance et l’intention, et même une sorte de swing machiniste qui convient parfaitement à la reproduction via bébé Serblin, où le travail ciselé du mixage, pétrit par la pulsion énergétique de l’intégré, impose la carrure bien trempée de chacune des idées très séquencées de la production, incluant des effets de placement singulièrement théâtraux, une saillie de synthé au fond à droite, le riff de guitare à la sonorité si personnalisée (et un essai de chorus à la guitare si éblouissant qu’on devine la langue entre les lèvres et la sueur au front du virtuose en herbe), les alternances d’un batteur nettement plus professionnel que les autres lui aussi parfaitement positionné et proportionné dans la disproportion, et qui, sous la pression (attention, ce n’est pas Mike Tyson quand même) dans le dos exercée par ce tout petit machin, incisif et affuté comme une flèche (je ne parle pas des musiciens), donnent vraiment un sourire de sale gosse…
Par conséquent, je rêve du même morceau joué, je ne sais pas moi, par FFF ?
La scène sonore, nous l’avons par ailleurs évoquée via les lectures de la 2e Symphonie de Prokofiev : pas spectaculaire, pas outrageusement exagérée mais plausible et contenue.
L’intégré Serblin n’ouvre pas sur le panorama hyperbolique d’Avatar 14 resucé par l’arrière-petit-fils de James Cameron : s’il sait positionner les intervenants sur une scène large profonde, architecturé, on se rend compte aussi qu’il limite les réverbérations, le fourmillement des indices définissant un volume de salle et propose plutôt un redimensionnement captivant qui fait accepter que le Musée Océanographique de Monaco est un pan de l’Océan et le Grand Bleu le partage émotionnel d’un rêve d’infinitude.
En cela, Performer est moins respirant et enveloppant que son grand frère Frankie.
Somme toute, si la hifi permet de rêver le Grandeur Nature ou encore vouloir de temps en temps y retourner, le pari est réussi !
Scène sonore :
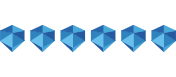

Expressivité :
Le petit Serblin est un excellent choix si on est attaché – sans dépenser une fortune garante de rien - à l’envie de siroter les instants délicieux ou frémissants d’instants fragiles, chargés d’un autre sens que la démonstration de beauté factice caractérisant bon nombre de ses rivaux, gommant parallèlement la diversité des attaques comme les intervalles de prolongement vibrants des notes.
Il fait honneur, par exemple, à l’hommage rendu à la musique française par l’oublié Fou Ts’Ong (décédé à Londres de la covid-19 en 2020), né en Chine (en 1934 donc avant de mourir) et de culture chinoise, qui en 1998 nous a offert une véritable transmutation des Préludes de Debussy.
A ma grande surprise, la proposition du piano de Fou Ts’Ong par le petit Italien laisse percevoir une part différente d’humanité, quand bien même on ne s’immerge pas tout à fait à fond dans « l’univers » propre à l’artiste du fait, je suppose, de ce son très direct, abrupt et sans concession qu’il revendique.
En la matière, il est quand même un des tous meilleurs que nous ayons testés, à l’exception d’objets bien plus coûteux.
On le vérifiera en savourant avec ravissement l’humble reprise par Rokia Traoré du difficile (après Billie Holiday) Strange Fruit, album Né So. La guitare vibrant en intro, la basse pour une fois pas hypertrophiée et la sensibilité du vibrato, pleurant juste comme il faut pour contourner le phrasé maniériste de tant de ses collègues, n’insistant qu’avec modération sur les mots chargés de noirceur… On regrettera tout au plus – et vraiment dans l’absolu – une simplification des modelés sur les souples déclinaisons mélodiques du phrasé de la Malienne, ce qui ne sera perceptible que sur des enceintes particulièrement libres, à croire que cet appareil pourtant d’apparence frêle, ne déteste pas être un peu sollicité ! Une forme de quête d’universalité ?
En ce qui concerne l’artiste, je la trouve plus touchante dans Beautiful Africa que j’ai eu envie de réécouter dans la foulée, où ses effets techniques de voix (notamment les chansons en Bambara) traduisent des sentiments plus directs, sans la moindre connexion possible à quelque manie que ce soit, où son chant puissant, tonique et feutré fait merveille.
Pour en revenir à l’objet du jour, il ne faut pas oublier que, dans notre domaine, une totale universalité de comportement ne fait que dénoncer le nivellement par le bas, dont le haut-de-gamme est particulièrement friand en nous écartant totalement de la moindre idée de plausibilité au profit d’avatars déviants.
Comme si on devait comparer les vérités profondes émises sur les réseaux sociaux à l’analyse de la philosophie d’Emmanuel Kant (critique de la raison pure, critique de la raison pratique, critique de la faculté de juger).
Précisément la simplification de pensée que nous combattons chez LeBeauSon, où immanence, permanence et transcendance sont des sujets de questionnement quotidiens (modestement et rapportés à notre travail périlleux de « petits jugeaillons »).
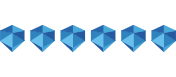
Toutes proportions gardées
Plaisir subjectif :
Je sèche… Personnellement, ce petit machin m’a emballé, tout autant que les visiteurs de passage qui ne voyaient pas forcément ce qui était branché. Or, pour éviter les préjugés, mieux vaut ne pas le regarder avant de l’écouter : il fait un peu frêle, non ?
Côté pratique, il est irréprochable : entrée phono de qualité (je n’aime pas beaucoup l’idée des « plugs », mais en pratique, m’est avis qu’on n’en aura pas souvent besoin), convertisseur intégré, lecteur réseau possible, ce bidule comblera de bonheur tous ceux qui n’ont pas le culte de la hifi hypertrophiée… Une bonne petite paire d’enceintes, une platine vinyle sympa, et hop, on en remontrera à beaucoup d’installations prétentieuses !
Et on pourra sans hésiter l’associer à plus qu’une « bonne petite paire d’enceintes » !
A condition d’avoir à l’esprit que le Performer de Serblin & Son prend le contre-pied de beaucoup d’objet dans sa gamme, préférant la nervosité et l’ardeur à l’émollient maquillé, ne négligeant toutefois pas les timbres, la délicatesse, le swing…
Alors quel est le revers de la médaille ? Un léger manque de corps ? Je crois, oui…
Mais il y a tant d’enceintes qui auraient besoin d’un coach sportif que ça lui ouvre une autoroute vers le succès !
??????
Rapport Qualité/Prix :
Alors là, le doute n’est pas permis.